NEWS
guy
CAN 2025 au Maroc : diplomatie sportive, arbitrage et recomposition des rapports de force africains

La finale de la 35ᵉ Coupe d’Afrique des nations, disputée au Maroc entre le pays hôte et le Sénégal, et remportée par les Lions de la Teranga sur le score de 1 but à 0, a constitué l’aboutissement sportif d’une compétition à haute valeur politique. Au-delà du résultat, cette CAN s’inscrit dans une stratégie diplomatique assumée, où le football devient un instrument central de projection d’influence, de légitimation institutionnelle et de leadership continental.
Le Maroc et la CAN : une vitrine diplomatique stratégique
Pour le Maroc, l’organisation de la CAN dépasse largement le cadre sportif. Elle s’inscrit dans une politique cohérente de diplomatie d’influence reposant sur trois piliers : infrastructures modernes, crédibilité organisationnelle et capacité à fédérer le continent. Après le retour du Royaume au sein de l’Union africaine et sa candidature à l’organisation de grandes compétitions mondiales, la CAN constitue une démonstration de puissance douce, destinée à renforcer son positionnement comme acteur incontournable du sport africain.
En accueillant les délégations, les dirigeants politiques et les instances sportives, Rabat transforme la CAN en plateforme diplomatique informelle, où se nouent alliances, soutiens et rapports de force, notamment au sein de la CAF.
La CAF au cœur des équilibres politiques africains
La Confédération africaine de football n’est plus seulement une instance sportive. Elle est devenue un espace de négociation politique, où s’expriment les rivalités régionales, les influences étatiques et les ambitions personnelles. La gestion arbitrale de la compétition, notamment l’usage de la VAR, a révélé les tensions persistantes autour de la neutralité institutionnelle et de la confiance des États membres.
Les incidents liés au matériel des gardiens de but du Congo et du Sénégal, survenus lors de rencontres distinctes, ont alimenté un sentiment de désorganisation et de fragilité logistique, parfois instrumentalisé dans les discours politiques pour dénoncer des traitements jugés inéquitables. Ces épisodes, bien que ponctuels, ont nourri une perception d’asymétrie dans la gestion des équipes, perception particulièrement sensible dans un contexte où chaque détail est interprété à travers le prisme du rapport de force.
La finale Maroc–Sénégal : symbole d’un leadership sportif disputé
La confrontation entre le Maroc et le Sénégal en finale n’était pas seulement sportive. Elle opposait deux modèles d’influence. D’un côté, le Maroc, hôte, misant sur l’organisation, les infrastructures et la diplomatie sportive. De l’autre, le Sénégal, champion en titre et incarnation d’un football africain performant sur la scène mondiale, fort de ses succès internationaux et de sa crédibilité sportive.
La victoire sénégalaise, acquise sur la plus petite des marges, a renforcé le statut du Sénégal comme puissance sportive africaine, tout en rappelant que le soft power ne se décrète pas uniquement par l’accueil des événements, mais aussi par les résultats sur le terrain.
Enjeux géopolitiques et crédibilité du football africain
Dans un contexte international marqué par la concurrence entre continents pour l’influence sportive, la CAN est devenue un marqueur de crédibilité. Chaque controverse arbitrale, chaque dysfonctionnement organisationnel affaiblit la capacité de l’Afrique à parler d’une seule voix dans les instances mondiales comme la FIFA.
Pour le Maroc, l’enjeu est désormais de transformer l’essai : faire de cette CAN un argument en faveur d’une gouvernance sportive africaine modernisée et crédible. Pour la CAF, il s’agit de restaurer la confiance des États et des joueurs, condition indispensable pour que le football demeure un levier de cohésion plutôt qu’un facteur de fragmentation.
La CAN 2025 au Maroc illustre parfaitement l’évolution du football africain vers un espace de diplomatie active. Entre ambitions nationales, équilibres institutionnels et quête de légitimité internationale, la compétition révèle que le ballon rond est désormais un outil stratégique. À défaut d’une gouvernance irréprochable, le soft power africain risque cependant de se heurter à ses propres contradictions.
Guy EKWALLA
Pourquoi Jean-Pierre Amougou Belinga doit être libéré : analyse juridique d’une détention qui interroge l’État de droit
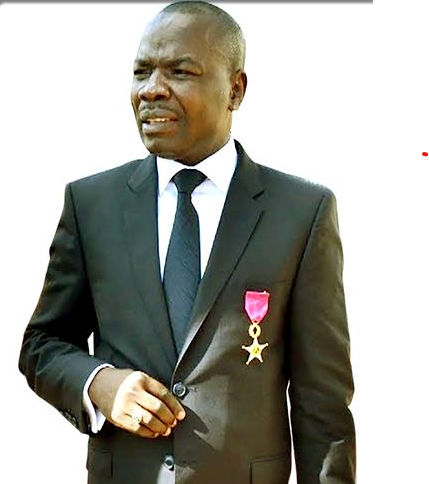
Plus de deux ans après l’assassinat brutal du journaliste Martinez Zogo, l’affaire continue de secouer l’opinion publique camerounaise. Si l’émotion initiale était légitime, le temps judiciaire impose désormais une autre exigence : le respect strict du droit. Au cœur de ce dossier sensible, la situation de Jean-Pierre Amougou Belinga, détenu malgré une ordonnance initiale favorable et des témoignages concordants l’innocentant, pose une question fondamentale : la justice militaire respecte-t-elle encore pleinement la présomption d’innocence garantie par les lois camerounaises ?
Rappel des faits : de l’émotion nationale à l’emballement judiciaire
L’affaire dite Martinez Zogo débute en janvier 2023 avec l’enlèvement, la torture et l’assassinat du journaliste, dont le corps est retrouvé dans des circonstances d’une extrême violence. Face à l’onde de choc nationale et internationale, les autorités annoncent rapidement l’ouverture d’une enquête confiée à la gendarmerie, puis la saisine du tribunal militaire de Yaoundé, au motif de l’implication présumée d’éléments des forces de défense.
Dans ce contexte de forte pression politique, médiatique et diplomatique, plusieurs personnalités civiles et militaires sont interpellées, dont Jean-Pierre Amougou Belinga, homme d’affaires et patron de presse. Son arrestation repose essentiellement sur des soupçons indirects, sans flagrant délit ni preuve matérielle publiquement établie à ce stade.
Une première ordonnance judiciaire favorable ignorée de fait
Un élément central, souvent minimisé dans le débat public, mérite pourtant une attention particulière : la première ordonnance rendue par le juge d’instruction, qui concluait à l’absence d’éléments suffisants justifiant le maintien en détention de Jean-Pierre Amougou Belinga.
Cette décision judiciaire, régulièrement rendue et motivée en droit, reconnaissait implicitement que :
-
les charges étaient insuffisamment étayées ;
-
le lien direct entre le mis en cause et les faits reprochés n’était pas établi ;
-
les conditions légales du mandat de détention provisoire n’étaient pas réunies.
Or, dans un État de droit, une ordonnance de ce type devrait produire ses effets immédiats. Le fait qu’elle n’ait pas conduit à une libération effective interroge sérieusement sur le respect de la hiérarchie des normes et de l’autorité de la chose jugée, y compris devant une juridiction militaire.
Des témoignages concordants qui innocentent le prévenu
Au fil de l’instruction, plusieurs coaccusés, notamment des éléments des forces de sécurité poursuivis pour exécution matérielle des faits, ont livré des témoignages constants et concordants. Tous affirment, sous procès-verbal, que Jean-Pierre Amougou Belinga :
-
n’a donné aucun ordre,
-
n’a participé à aucune réunion préparatoire,
-
n’a financé ni organisé l’opération criminelle.
Ces déclarations, versées au dossier, constituent des éléments à décharge majeurs que le juge ne peut ignorer sans violer le principe d’impartialité de l’instruction. En droit pénal camerounais, comme en droit comparé, le doute profite toujours à l’accusé (in dubio pro reo).
La présomption d’innocence : un principe constitutionnel impératif
Le droit camerounais est pourtant clair.
La Constitution garantit expressément la présomption d’innocence, principe cardinal selon lequel nul ne peut être traité comme coupable avant une condamnation définitive.
De même, le Code de procédure pénale rappelle que :
-
toute personne poursuivie est présumée innocente ;
-
la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, strictement encadrée ;
-
elle ne peut se justifier que par des nécessités précises : risque de fuite, trouble à l’ordre public, pression sur les témoins.
Or, dans le cas d’espèce :
-
le mis en cause présente toutes les garanties de représentation ;
-
l’enquête est achevée sur l’essentiel ;
-
aucun acte d’entrave à la justice ne lui est imputé.
La prolongation de la détention apparaît donc juridiquement fragile, voire contraire à l’esprit et à la lettre de la loi.
Tribunal militaire : une compétence qui n’abolit pas les droits fondamentaux
Le fait que l’affaire soit instruite devant le tribunal militaire ne saurait justifier une dérogation aux libertés fondamentales. La justice militaire camerounaise demeure soumise :
-
à la Constitution ;
-
aux conventions internationales ratifiées par le Cameroun ;
-
aux principes universels du procès équitable.
La compétence exceptionnelle du tribunal militaire ne transforme pas la détention provisoire en peine anticipée.
que peut juridiquement revendiquer le présumé innocent ?
Au regard du droit positif camerounais, Jean-Pierre Amougou Belinga, en tant que présumé innocent, est fondé à :
-
solliciter sa mise en liberté immédiate pour détention injustifiée ;
-
invoquer l’excès de durée de la détention provisoire ;
-
prétendre, le moment venu, à une réparation pour détention arbitraire, si aucune culpabilité n’est établie.
L’affaire Martinez Zogo exige vérité et justice. Mais elle exige aussi que la justice ne sacrifie pas ses propres principes sous le poids de l’émotion. Libérer un innocent présumé n’est pas un aveu de faiblesse : c’est l’affirmation de l’État de droit.
Guy EKWALLA
Missile hypersonique “Oréshnik” : Moscou franchit un nouveau seuil dans la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine a franchi un nouveau palier stratégique. La Russie affirme avoir utilisé, pour la première fois en conditions réelles, un missile hypersonique de nouvelle génération baptisé “Oréshnik”, lors d’un bombardement massif ayant visé plusieurs infrastructures ukrainiennes. Cette attaque, qui aurait causé plusieurs morts, marque une escalade technologique et militaire majeure, aux implications bien au-delà du champ de bataille ukrainien.
Une arme de rupture au cœur de la stratégie russe
Selon les autorités russes, le missile Oréshnik appartiendrait à la catégorie des armes hypersoniques manœuvrables, capables d’atteindre des vitesses supérieures à Mach 5 tout en modifiant leur trajectoire. Un tel profil rend ces missiles extrêmement difficiles à intercepter, y compris par les systèmes de défense antiaérienne occidentaux les plus avancés.
Si Moscou reste volontairement vague sur les caractéristiques techniques exactes de l’Oréshnik, le message politique est clair : la Russie entend démontrer sa supériorité technologique et sa capacité à frapper vite, loin et sans avertissement. L’objectif n’est pas seulement militaire, il est aussi psychologique et diplomatique.
Un bombardement massif aux conséquences humaines lourdes
Les frappes associées à l’utilisation présumée de l’Oréshnik se sont inscrites dans une attaque coordonnée de grande ampleur, ciblant des infrastructures énergétiques, logistiques et urbaines en Ukraine. Plusieurs sources font état de victimes civiles, renforçant les inquiétudes quant à l’intensification du conflit en plein hiver, période critique pour l’approvisionnement énergétique du pays.
Kiev n’a pas confirmé de manière indépendante la nature exacte du missile utilisé, mais reconnaît une frappe d’une puissance et d’une précision inhabituelles, laissant penser à l’emploi d’un vecteur inédit.
Un signal adressé à l’OTAN et aux alliés de Kiev
Au-delà du théâtre ukrainien, l’annonce russe s’adresse directement aux États-Unis et à l’OTAN. En exhibant un nouvel arsenal hypersonique, Moscou cherche à redéfinir les lignes rouges et à dissuader toute escalade occidentale, notamment en matière de livraisons d’armes de longue portée à l’Ukraine.
Cette démonstration intervient dans un contexte de guerre d’usure, où chaque camp tente de reprendre l’initiative stratégique. Pour la Russie, l’Oréshnik devient un outil de pression : il rappelle que le conflit peut basculer dans une dimension encore plus dangereuse.
Une course aux armements relancée
L’utilisation d’un missile hypersonique de nouvelle génération relance de facto la course aux armements de haute technologie. Les puissances occidentales, déjà engagées dans leurs propres programmes hypersoniques, pourraient accélérer leurs investissements, au risque de nourrir une spirale sécuritaire difficile à contenir.
Sur le plan international, cette escalade pose aussi la question du droit de la guerre et de la protection des civils face à des armes conçues pour contourner toute défense existante.
Vers un conflit encore plus imprévisible
Qu’il s’agisse d’un déploiement ponctuel ou du début d’une nouvelle doctrine militaire, l’Oréshnik symbolise une réalité inquiétante : la guerre en Ukraine devient un laboratoire des conflits du futur. Plus rapide, plus technologique, plus imprévisible.
Dans ce contexte, chaque annonce, chaque frappe et chaque innovation militaire rapproche un peu plus le conflit d’un point de non-retour stratégique, dont les répercussions pourraient dépasser largement les frontières ukrainiennes.
Guy EKWALLA
Les États-Unis annoncent leur retrait de 66 organisations internationales jugées « inefficaces et nuisibles »

Washington a officialisé ce jour une décision majeure de politique étrangère : le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales, accusées d’être à la fois inefficaces, coûteuses et contraires aux intérêts nationaux américains. L’annonce a été faite par le Département d’État, dans le cadre de l’application d’un ordre exécutif présidentiel visant à redéfinir l’engagement multilatéral des États-Unis.
Selon les autorités américaines, cette décision s’inscrit dans une volonté de rationalisation stratégique. « Les États-Unis ne financeront plus des structures qui ne produisent pas de résultats tangibles, qui servent des agendas idéologiques ou qui affaiblissent la souveraineté américaine », indique le communiqué officiel. Washington estime que plusieurs de ces organisations ont dérivé de leurs missions initiales, tout en imposant des contraintes politiques, réglementaires ou financières jugées excessives.
Une critique du multilatéralisme contemporain
L’administration américaine dénonce notamment :
-
une bureaucratisation excessive,
-
un manque de transparence dans la gouvernance,
-
une instrumentalisation politique par certains États membres,
-
et une faible efficacité opérationnelle, malgré des budgets en constante augmentation.
Sans publier immédiatement la liste exhaustive des 66 organisations concernées, le Département d’État précise qu’elles couvrent des domaines variés, allant de la coopération culturelle et éducative à des agences techniques, environnementales et consultatives. Les contributions financières américaines à ces entités représentaient plusieurs milliards de dollars par an.
Réactions internationales contrastées
La décision a suscité des réactions rapides sur la scène internationale. Plusieurs partenaires européens ont exprimé leur préoccupation, craignant un affaiblissement du système multilatéral et une perte de coordination sur des enjeux globaux tels que la santé, le climat ou la régulation économique. D’autres États, en revanche, ont salué un « signal fort » contre ce qu’ils considèrent comme une dérive technocratique des institutions internationales.
Des responsables onusiens ont, de leur côté, regretté un choix « unilatéral », tout en affirmant que les organisations concernées « continueront à remplir leurs missions avec ou sans le soutien américain ».
Une nouvelle doctrine assumée
Pour Washington, ce retrait ne signifie pas un isolement, mais une réorientation. Les États-Unis affirment vouloir privilégier :
-
des partenariats ciblés,
-
des accords bilatéraux ou ad hoc,
-
et des engagements internationaux fondés sur des résultats mesurables.
Cette annonce confirme une inflexion durable de la politique étrangère américaine : un multilatéralisme conditionnel, subordonné à l’intérêt national et à l’efficacité concrète. Un choix qui redessine, une fois encore, les équilibres de la gouvernance mondiale.
Guy EKWALLA
Sécurité européenne : à Paris, une coalition internationale réaffirme des garanties de sécurité fortes pour l’Ukraine

Paris – La question de la sécurité européenne est revenue au premier plan de l’agenda diplomatique international à l’issue d’une déclaration solennelle publiée à Paris par une coalition de pays incluant les États-Unis et l’Ukraine. Ce texte marque un engagement renouvelé et renforcé en faveur de garanties de sécurité durables pour Kiev, dans un contexte de guerre prolongée et d’incertitudes géopolitiques persistantes sur le continent européen.
Réunis dans la capitale française, les membres de cette coalition – souvent qualifiée de « coalition des volontaires » – ont affirmé leur volonté commune de ne pas laisser l’Ukraine seule face aux menaces militaires et stratégiques qui pèsent sur sa souveraineté. Cette initiative intervient alors que le conflit russo-ukrainien continue de remodeler en profondeur l’architecture de sécurité européenne.
Un signal politique fort envoyé à Moscou
La déclaration publiée à Paris vise avant tout à envoyer un message clair à la Russie : les partenaires occidentaux de l’Ukraine restent unis et déterminés. Les signataires insistent sur la nécessité de garanties de sécurité « robustes, crédibles et durables », allant au-delà d’un simple soutien militaire ponctuel.
Ces garanties comprennent notamment le renforcement des capacités de défense ukrainiennes, une coopération militaire accrue, ainsi qu’un engagement politique à long terme pour dissuader toute nouvelle agression. Sans évoquer explicitement une adhésion immédiate de l’Ukraine à l’OTAN, la coalition assure néanmoins que la sécurité de l’Ukraine est indissociable de celle de l’Europe.
Les États-Unis au cœur du dispositif
La participation active des États-Unis à cette déclaration confère à l’initiative une portée stratégique majeure. Washington réaffirme son rôle central dans la défense du flanc oriental de l’Europe et dans le soutien à Kiev, malgré les débats internes et les pressions politiques liées à la durée et au coût du conflit.
Pour les diplomates américains, il s’agit de préserver la crédibilité des alliances occidentales et de démontrer que les tentatives de remise en cause de l’ordre international fondé sur des règles ne resteront pas sans réponse. Le texte souligne également l’importance de la coordination transatlantique, en particulier avec les pays européens les plus exposés.
L’Ukraine en quête de stabilité à long terme
Du côté ukrainien, cette déclaration est perçue comme une étape clé vers une sécurité pérenne, même en l’absence d’un règlement politique définitif du conflit. Les autorités de Kiev réclament depuis plusieurs mois des mécanismes clairs permettant d’éviter une répétition des scénarios passés, où des engagements diplomatiques se sont révélés insuffisants face à l’agression militaire.
Pour l’Ukraine, les garanties évoquées à Paris doivent servir de pont entre la situation actuelle et une future intégration aux structures de sécurité euro-atlantiques. Elles sont aussi cruciales pour rassurer la population et les investisseurs, dans un pays profondément affecté par la guerre.
Une Europe face à ses responsabilités
Cette initiative parisienne illustre enfin une prise de conscience accrue des États européens quant à leur rôle en matière de défense collective. La guerre en Ukraine a mis en évidence les limites des dispositifs existants et accéléré les réflexions sur l’autonomie stratégique européenne, sans pour autant rompre avec l’allié américain.
En réaffirmant leur engagement commun, les membres de la coalition cherchent à poser les bases d’une paix durable, fondée non sur des concessions forcées, mais sur la dissuasion, la solidarité et le respect du droit international.
Alors que le conflit se prolonge, cette déclaration rappelle une réalité désormais largement partagée dans les capitales occidentales : l’avenir de la sécurité européenne se joue en Ukraine, et les choix faits aujourd’hui auront des conséquences durables pour l’équilibre du continent.
GUY EKWALLA
Affaire Martinez Zogo : quand les témoignages rebattent les cartes au tribunal militaire

L’affaire de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, qui continue de susciter une forte émotion au Cameroun et au sein de la diaspora. Connais un tournant significatif à la suite des récentes déclarations de l’agent de renseignement Alain Ekassi. Ses témoignages, livrés dans un contexte judiciaire particulièrement sensible, contribuent à redessiner les lignes d’analyse d’un dossier déjà marqué par de nombreuses zones d’ombre.
Selon les propos attribués à Alain Ekassi, ce dernier met directement en cause l’ancien maire de Bibey, Martin Savom, qu’il désigne comme un acteur central dans la chaîne des événements ayant conduit à la mort du journaliste. Plus encore, l’agent affirme n’avoir jamais entretenu le moindre contact avec la Direction générale du renseignement extérieur (DGRE), institution longtemps évoquée, explicitement ou implicitement, dans l’opinion publique comme un rouage possible de l’affaire.
Cette déclaration est loin d’être anodine. Elle tend à affaiblir l’hypothèse d’une implication structurelle de certains services de renseignement et pourrait, à ce titre, conforter le travail d’instruction mené par le juge Sikati II. Ce dernier avait, rappelons-le, signé une levée d’écrou en faveur de Jean-Pierre Amougou Belinga, présenté jusqu’ici comme le principal suspect dans ce dossier à forte charge politique et médiatique.
D’un point de vue strictement juridique, les propos d’Alain Ekassi posent une question centrale : celle de la cohérence globale de l’accusation. Si l’agent de renseignement nie tout lien opérationnel avec la DGRE et réoriente la responsabilité vers des acteurs civils identifiés, l’architecture de l’accusation initiale s’en trouve fragilisée. Or, en droit pénal, et plus encore devant une juridiction militaire, la charge de la preuve demeure un impératif cardinal.
Dans ce contexte, la situation de Jean-Pierre Amougou Belinga mérite une relecture rigoureuse, détachée des pressions émotionnelles et des narratifs préconçus. En l’état des éléments rendus publics, et en tenant compte des témoignages versés au dossier, une issue semble s’imposer sur le plan procédural : la relaxe du prévenu, faute d’éléments suffisamment probants établissant sa responsabilité directe ou indirecte dans les faits reprochés.
Il appartient désormais au tribunal militaire de trancher, non sur la base des perceptions ou des attentes de l’opinion, mais au regard exclusif du droit et des faits judiciairement établis. Dans une affaire aussi emblématique, l’enjeu dépasse les individus concernés : il touche à la crédibilité de l’institution judiciaire et à sa capacité à garantir un procès équitable, même sous le poids d’une forte pression nationale.
L’affaire Martinez Zogo entre ainsi dans une phase décisive, où la rigueur juridique devra prévaloir sur l’émotion, et où chaque témoignage devra être apprécié à l’aune de sa valeur probante, et non de son impact médiatique.
GUY EKWALLA
Sélectionneurs sous pression : pourquoi l’Afrique change autant d’entraîneurs — et comment le Cameroun illustre un mal systémique

Le limogeage précipité de Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables, à seulement trois semaines d’une compétition majeure, n’est pas un épisode isolé mais le symptôme d’une crise profonde de gouvernance footballistique en Afrique. Alors que l’Europe bâtit ses victoires sur la stabilité et la planification, les sélections africaines semblent souvent naviguer à vue, enchaînant les entraîneurs au gré des crises et des pressions politiques. Comparaison internationale, données, enjeux économiques : plongée dans un système où durer est devenu un luxe.
Le banc le plus exposé du monde
Il existe dans le football un paradoxe universel : tout le monde réclame la stabilité… mais rares sont ceux qui lui laissent le temps d’agir.
En analysant les données mondiales, un constat s’impose :
-
459 jours en moyenne,
-
243 jours en médiane,
voilà ce que dure réellement un entraîneur dans le monde, clubs et sélections confondus.
Autrement dit : en moyenne, un entraîneur ne termine pas deux saisons complètes.
Dans certaines zones — notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud — la durée réelle est encore plus courte.
Mais derrière la statistique globale se cachent des dynamiques très différentes selon les continents.
Cameroun : l’instabilité comme norme
Le Cameroun est une nation de football, de passion, de tension aussi. Le statut des Lions Indomptables dépasse le cadre sportif : c’est une institution culturelle, un symbole national, un outil de communication politique.
Et cela se ressent sur la gestion du staff technique.
Sur les 10 à 12 dernières années : entre 5 et 7 sélectionneurs se sont succédé.
Certains sont restés quelques mois, parfois quelques semaines.
D’autres ont été poussés vers la sortie sans véritable projet alternatif derrière.
Le cas Marc Brice n’est donc ni isolé ni anecdotique.
Les raisons ?
-
Résultats jugés insuffisants.
-
Pressions médiatiques immédiates.
-
Interférences politiques.
-
Fédérations instables.
-
Absence d’un plan stratégique sur 4 ou 6 ans, comme dans les grandes nations.
En somme : le Cameroun change souvent d’entraîneur parce que son système rend impossible une vision long terme.
Europe : construire, planifier, durer
À l’opposé du modèle africain, les grandes nations européennes misent sur la stabilité comme levier de performance.
France : un cas d’école
Depuis 2012, Didier Deschamps incarne la continuité.
Plus de 13 ans à son poste : un record moderne.
Son bilan ?
-
Champion du monde 2018
-
Finaliste de l’Euro 2016
-
Finaliste mondial 2022
-
Vainqueur de la Ligue des Nations 2021
-
Une série d’éliminations toujours au minimum en quarts ou demi-finales
La France a compris qu’un projet international se construit sur des longs cycles.
Une sélection, ce n’est pas un club : les joueurs se retrouvent peu, les automatismes se fabriquent dans la durée.
Belgique : stabilité raisonnée
Avec Roberto Martínez puis Domenico Tedesco, la Belgique a privilégié des mandats continus, généralement proches dès trois ans minimum.
Cette paix technique a accompagné la fameuse “génération dorée”.
Angleterre, Brésil : changement oui, brusquerie non
Gareth Southgate est en poste depuis 2016.
Au Brésil, les cycles duraient habituellement 3 à 4 ans, alignés sur les Coupes du monde.
Bref : en Europe, le changement se prépare. En Afrique, il se subit.
Et la Chine ? Le cas du football émergent
La Chine illustre un autre modèle : celui d’un pays en construction sportive.
Les sélectionneurs s’y succèdent rapidement, souvent tous les 1 à 2 ans, mais dans le cadre d'un projet d’État où l’expérimentation est assumée.
→ L’instabilité y est stratégique, pas chaotique.
Changer un entraîneur à trois semaines d’une CAN : un pari presque perdu d’avance
Le Cameroun a déjà vu des miracles. Mais en football moderne, les miracles deviennent rares.
Changer un sélectionneur à 3 semaines d’un tournoi pose quatre problèmes majeurs :
-
Aucun système de jeu n’est assimilable en si peu de temps.
-
Les joueurs perdent leurs repères, surtout dans une équipe où les automatismes sont déjà fragiles.
-
Le climat interne devient électrique : certains gagnent leur place, d’autres la perdent.
-
La préparation mentale est fragilisée, alors que la CAN exige une concentration absolue.
Même si le nouveau coach était déjà dans le staff technique, trois semaines restent extrêmement courtes dans une préparation internationale.
Les chances de réussite ?
Mathématiquement faibles.
Historiquement rares.
Sportivement fragilisées.
CAN 2025 au Maroc : les favoris n’ont rien d’un hasard
Même si le Cameroun aborde la compétition en pleine transition technique, d'autres nations avancent avec une trajectoire plus claire.
Les favoris probables :
-
Maroc : continuité, effectif mûr, projet fédéral structuré.
-
Sénégal : Aliou Cissé, en poste de 2015 à 2024,puis remplacé par Pape Thiaw, est un symbole de stabilité africaine.
-
Côte d’Ivoire : dynamique positive après le titre continental.
-
Égypte : expérience, discipline tactique, culture de la compétition.
La logique est implacable : ceux qui construisent, gagnent. Ceux qui improvisent, espèrent.
Pourquoi le football africain manque-t-il d’attractivité ? Le nerf de la guerre : l’argent
La question des salaires
J'évoque ici la prise de conscience qu'un salaire moyen de 1 million FCFA par mois pour un joueur local pourrais permettre a ce que les joueurs africains performent et acquière le style de jeu africain perdu depuis belle lurette
Dans les faits :
-
seuls quelques clubs élites y parviennent,
-
la majorité tourne entre 200 000 et 500 000 FCFA,
-
les primes sont variables,
-
les retards de paiement fréquents.
Pourquoi l’Afrique ne peut-elle pas payer plus ?
Parce que les championnats :
-
n’ont pas de droits TV significatifs,
-
manquent de sponsors puissants,
-
souffrent d’infrastructures inadaptées,
-
n'ont pas d’industries dérivées rentables,
-
manquent de gouvernance professionnelle.
En Europe, un joueur moyen de Ligue 2 peut gagner 10 à 20 fois plus qu’un joueur de première division africaine.
Un cercle vicieux :
Faibles salaires → exode massif → baisse du niveau → faibles revenus → et retour au point de départ.
Alors, combien de temps un sélectionneur devrait-il réellement durer ?
Dans le monde idéal :
-
3 à 6 ans, soit le temps d’un cycle complet (CAN + qualifications + Coupe du monde).
C’est le standard des nations performantes.
Dans la réalité africaine actuelle :
-
12 à 18 mois en moyenne,
-
2 à 3 ans pour les longs mandats,
-
4 ans et plus est exceptionnel.
Didier Deschamps : le standard ultime
Avec plus de 14 ans à la tête des Bleus, il établit un record moderne comparable à ceux des grandes dynasties (Löw, Óscar Tabárez…).
Il incarne ce que le Cameroun n’a pas :
une vision, une stabilité, une planification.
Ce que le Cameroun doit retenir de sa propre histoire
Le football n’est pas seulement une question de talent.
C’est une question de temps, de structure, de continuité.
Le Cameroun a les joueurs, la culture, la passion.
Ce qui lui manque, c’est ce que l’Europe a compris depuis longtemps :
un projet ne se change pas comme un schéma tactique.
Si les Lions Indomptables espèrent redevenir une puissance africaine stable, ils devront faire ce que le football exige le plus — et que la politique accepte le moins :
laisser un entraîneur travailler.
Guy EKWALLA
Jean-Pierre Amougou Belinga : entre justice contestée, jeux de pouvoir et fidélité au régime — une détention qui interroge

Incarcéré depuis 2023 dans le cadre de l’affaire Martinez Zogo, Jean-Pierre Amougou Belinga demeure au cœur d’un tourbillon judiciaire et politique qui divise l’opinion camerounaise. Alors qu’une ordonnance de mise en liberté signée par le juge Sikati avait brièvement laissé espérer un dénouement favorable, son maintien en détention soulève de nombreuses questions. Suspecté à tort selon ses soutiens de viser le fauteuil présidentiel, l’homme d’affaires a pourtant toujours affiché une loyauté sans faille envers le président Paul Biya. Visionnaire économique, patron influent, figure respectée de la diaspora, le Zom'loa des Zoml'oa continue d’alimenter débats, interrogations et mobilisation autour d’une seule revendication : sa libération.
I. Un nom qui dépasse le simple champ médiatique
Jean-Pierre Amougou Belinga n’est pas seulement un patron de presse. Il est devenu au fil des années l’une des figures les plus marquantes de la scène économique camerounaise. Issu d’un parcours atypique, souvent cité comme modèle d’ascension sociale, il a bâti un empire médiatique allant du journal L’Anecdote aux chaînes de télévision Vision 4, Télésud au magazine Africa Express et plusieurs autres du groupe l’Anecdote.
Un empire bâti sur l’ambition, la discipline et l’audace, qui lui a valu le respect d’une partie de la population et de la diaspora, où son nom est synonyme de réussite, leadership et patriotisme économique.
Un homme de pouvoir, mais pas un homme politique
Contrairement aux rumeurs qui ont circulé à certains moments de son ascension, Jean-Pierre Amougou Belinga n’a jamais affiché d’ambition présidentielle. Ses prises de position publiques, tout comme son engagement à travers ses médias, l’ont toujours présenté comme un allié déterminé du président Paul Biya.
Il a financé, soutenu et promu les actions du chef de l’État, ne s’en cachant jamais.
Les accusations de convoitise du pouvoir suprême apparaissent donc, pour beaucoup, comme une construction destinée à justifier le traitement sévère dont il fait aujourd’hui l’objet.
II. L’affaire Martinez Zogo : naissance d’un séisme national
Une disparition qui bouleverse le Cameroun
Lorsque le journaliste Martinez Zogo disparaît le 17 janvier 2023, puis est retrouvé mort cinq jours plus tard dans des conditions atroces, le Cameroun est secoué. La pression médiatique et internationale s’intensifie, et les regards se tournent immédiatement vers les pouvoirs publics, les services de renseignement… et le monde des médias.
La machine judiciaire se met en route
Dans un climat lourd, la justice ouvre un dossier tentaculaire visant plusieurs responsables sécuritaires et personnalités publiques.
Très vite, Jean-Pierre Amougou Belinga est cité, puis arrêté, avant d’être placé en détention provisoire.
Le choc est immense : comment un patron de médias, dont la rivalité professionnelle avec Zogo était connue, mais sans gravité apparente, aurait-il pu commanditer un acte aussi extrême ?
Pour ses proches, ses collaborateurs et la diaspora, l’accusation est non seulement infondée, mais relève d’une machination.
III. L’ordonnance de libération qui fait trembler la justice
Une première signature qui confirme les doutes
Fin 2023, une ordonnance de mise en liberté portant la signature du juge d’instruction Sikati II circule.
Cette ordonnance affirme que la détention de Jean-Pierre Amougou Belinga n’est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité.
Pour beaucoup, c’est la preuve que le dossier manque de fondements solides.
Ses avocats jubilent : justice est enfin en train de suivre son cours.
Mais soudain, un revirement spectaculaire
À peine l’ordonnance rendue publique, une seconde signature du même magistrat apparaît… affirmant que la première serait un faux.
Un revirement qui plonge l’opinion dans la stupeur et renforce la conviction d’une partie de la population qu’un bras de fer interne secoue les coulisses de la justice camerounaise.
Comment un juge d’instruction peut-il démentir sa propre signature ?
Pourquoi cette volte-face au moment précis où la libération devenait possible ?
Les critiques parlent d’influence, de pressions, de manipulations. Les défenseurs de l’État parlent, eux, de tentative de falsification du dossier.
Mais une certitude demeure : ce double document a entaché la crédibilité de la procédure.
IV. Des audiences qui s’enchaînent, mais une position qui ne change pas
Malgré les déclarations contradictoires au sein du dossier, malgré la confession d’un co-accusé se déclarant coupable, le tribunal militaire maintient Jean-Pierre Amougou Belinga en détention.
Pour la défense, l’acharnement est évident.
Pour ses partisans, les motivations sont ailleurs :
-
volonté de l’écarter durablement du paysage médiatique ?
-
tentative de neutraliser un acteur économique trop influent ?
-
pression d’acteurs externes redoutant son pouvoir de mobilisation ?
Ce maintien en détention devient pour beaucoup difficilement justifiable au regard de l’évolution du dossier.
V. Pourquoi le tribunal militaire tient-il à le garder derrière les barreaux ?
Une décision qui interroge profondément
L’implication du tribunal militaire dans une affaire impliquant un civil alimente les débats.
Plusieurs analystes estiment que cette juridiction, par sa structure hiérarchique, est davantage sensible à l’exécutif que les tribunaux civils.
D’où une question centrale :
la détention d’Amougou Belinga est-elle vraiment une conséquence juridique, ou une décision d’équilibre politique ?
Pour ses soutiens, les motivations réelles seraient :
-
limiter son influence politique et économique,
-
le neutraliser dans une période de transition sensible au Cameroun,
-
ou encore empêcher l’émergence d’un pôle médiatique trop indépendant.
VI. La diaspora camerounaise : un soutien massif et inébranlable
Dans les capitales européennes, la diaspora camerounaise s’exprime d’une seule voix :
Jean-Pierre Amougou Belinga doit être libéré.
Pour beaucoup d’entre eux, il est :
-
un entrepreneur visionnaire,
-
un employeur de milliers de jeunes,
-
un mécène et bâtisseur,
-
un symbole d’ascension sociale et de patriotisme économique.
Il bénéficie d’un véritable capital sympathie, fruit de ses investissements, de ses actions sociales et de sa générosité.
Son surnom — « le Zom'loa des Zom'loa » — reflète cet attachement affectif, mêlant respect, admiration et reconnaissance.
Pour ces communautés expatriées, son emprisonnement est vécu comme un affront, une injustice, voire une tentative d’étouffer les élites économiques nationales.
VII. Un homme utile au Cameroun, pas derrière les barreaux
Qu’on l’aime ou qu’on le critique, un fait demeure :
Jean-Pierre Amougou Belinga a créé des emplois, formé des professionnels, soutenu l’éducation et participé à la modernisation du paysage audiovisuel camerounais.
Pour la jeunesse qu’il emploie, il n’est pas seulement un patron :
il est un modèle.
L’empêcher de travailler, c’est priver le Cameroun d’un acteur économique de poids, dans un pays où l’emploi, la formation et l’entrepreneuriat sont des enjeux cruciaux.
VIII. Au-delà du cas Amougou Belinga : un miroir tendu à la justice camerounaise
Un procès qui dépasse la personne et englobe tout un système
L’affaire Belinga est devenue un symbole :
-
symbole des tensions internes,
-
symbole du rapport entre justice et exécutif,
-
symbole du poids de l’opinion publique,
-
symbole du rôle de la diaspora dans les débats nationaux.
La façon dont ce dossier sera bouclé déterminera, pour beaucoup, la perception de la justice camerounaise dans les prochaines années.
Un dossier qui appelle vérité, courage et transparence
L’affaire Jean-Pierre Amougou Belinga n’est pas seulement judiciaire. Elle est politique, sociale, économique, symbolique.
Elle met à nu des fragilités, des tensions et des contradictions dans un système où les frontières entre pouvoir, justice et influence sont parfois floues.
Pour ses partisans, il est innocent.
Pour ses accusateurs, il est un acteur clé du dossier Zogo.
Pour sa diaspora, il est un pilier, un repère, un bâtisseur.
Ce qui est certain, c’est que le Cameroun joue une partie de son image dans la manière dont ce dossier sera traité jusqu’au bout.
Et que la question restera brûlante tant que justice, transparence et vérité ne seront pas pleinement établies.
Guy EKWALLA
Ngondo Bruxelles 2025 : En communion avec les ancêtres

La première édition du grand rassemblement traditionnel Sawa au cœur de l’Europe
Le peuple Sawa du Benelux s’apprête à vivre un moment historique : la première édition du Ngondo Bruxelles, prévue le 6 décembre 2025. Cet événement exceptionnel, organisé par l’Association des Sawas du Benelux, marquera une étape symbolique dans la valorisation et la transmission des traditions ancestrales Sawa en Europe.
Le Ngondo, véritable pilier culturel et spirituel du peuple Sawa, est bien plus qu’une simple fête. C’est une communion avec les ancêtres, un rituel de reconnexion aux racines, un espace de paix, de sagesse et d’unité communautaire. À travers chants, danses, rituels traditionnels et échanges culturels, les participants revivront la profondeur et la richesse d’une civilisation fondée sur le respect, la solidarité et la mémoire.
L’édition 2025 à Bruxelles s’annonce comme un pont entre tradition et modernité, réunissant toutes les composantes du peuple Sawa — Douala, Bakoko, Bakweri, Balimba, Bankon et bien d’autres — dans un même élan de fraternité.
Au-delà de la célébration, le Ngondo Bruxelles 2025 portera un message fort : celui de la préservation du patrimoine spirituel et culturel Sawa, transmis de génération en génération, et désormais célébré au cœur du Benelux.
? Date : Samedi 6 décembre 2025
? Lieu : Bruxelles salle proximus lounge à Ever
? Heure : À partir de 20h
https://youtube.com/shorts/InmmeewMTiM?si=F7xX997QxJ2ggDOj
Ngondo Bruxelles 2025 — Ensemble avec les ancêtres, la tradition continue.
Guy EKWALLA
Côte d’Ivoire : Bruxelles salue les garanties d’une présidentielle sous haute vigilance

Côte d’Ivoire : Bruxelles salue les garanties d’une présidentielle sous haute vigilance
À quelques semaines d’une élection présidentielle cruciale, la Côte d’Ivoire cherche à rassurer ses partenaires internationaux.
Lors d’une conférence de presse tenue au Press Club Europe de Bruxelles, le ministre ivoirien de la Communication, Amadou Coulibaly, a détaillé les mesures prévues pour assurer un scrutin « conforme à la Constitution et au code électoral ».
En présence de diplomates, d’hommes d’affaires et de représentants de l’Union européenne, le ministre a insisté : « Ce n’est pas l’Europe qui dicte les règles », rappelant que l’absence de certains partis dans la course électorale relève de leurs propres choix.
Au cœur des préoccupations figurent également les réseaux sociaux, que le gouvernement entend réguler afin de prévenir les fausses informations et les tensions.
Amadou Coulibaly a par ailleurs réaffirmé la détermination d’Abidjan à lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, des signaux perçus comme rassurants par les partenaires européens.
Mais malgré ces engagements, l’inquiétude persiste.
Les populations gardent en mémoire les crises post-électorales de 2010 et les violences qui avaient suivi.
À l’approche du scrutin d’octobre, le contexte politique reste fragile.
Le ministre a toutefois conclu sur une note d’optimisme, assurant que la Côte d’Ivoire est prête à organiser une élection libre, transparente et apaisée, en appelant le peuple ivoirien à la paix et à la sérénité.
guy Ekwalla
POUR SOUTENIR L'ASSOCIATION, PARTENARIAT, DON, BENEVOLAT ET/ OU FAIRE UNE DEMANDE D'INFORMATION
A Propos
L'Association "Belgocam21" oeuvre pour des actions solidaires, sociales et constructives. Notamment, l'organisation de journées "Entraide & Paix" en Europe et en Afrique.
BELGOCAM21

Contact
- 75 Rue René Delbrouck. 4102 Seraing. Belgique
- (+32) 496 92 94 23
- (+32) 496 92 94 23
- info@belgocam21.com






